où est la critique de BD dans les journaux?
dans la série "lettres envoyées au devoir mais qui ne seront jamais publiées" (il y en a d'autres; je les incluerai sans doute ici éventuellement) voici mon réquisitoire pour plus de critique de BD dans les journaux. je l'ai envoyé au devoir parce que c'est le journal que je lis. le journal de montréal n'a pas de chronique littéraire donc ça ne sert à rien de leur envoyer quoi que ce soit. quant à la presse, ceux qui me connaissent savent dans quelle piètre estime je tiens le néfaste torchon petit-bourgeois.
mais voilà, le propre des lettres ouvertes est qu'elles sont ouvertes et donc, ouvrons grand...
Où est la critique de BD dans les journaux?
Chaque fin de semaine, lorsque j'ouvre le cahier Livres, j'ai ce petit espoir secret et un peu naïf d'y trouver une chronique intitulée "bande dessinée". Voeu rarement exaucé. Il est vrai qu'une fois de temps en temps, un article pointe son nez: le plus souvent court, superficiel, avare de développement. Et pourtant, tout autour, de longues analyses de fond sur tout ce que les librairies comportent comme essais, romans, recueils de nouvelles ou de poésie, livres jeunesse, livres de recettes, "beaux livres" et j'en passe.
Comment expliquer cet état de choses? La réponse facile, toute faite, mille fois entendue, est que la BD n'est pas un "genre sérieux" et qu'elle n'intéresse qu'un nombre marginal de lecteurs qu'on suppose peinant à passer à l'âge adulte. Le problème avec cette réponse est qu'elle relève du fantasme: d'un, la bande dessinée est un médium (parler de "genre" n'a pas beaucoup de sens); de deux, elle est tout aussi potentiellement "sérieuse" ou "farfelue" qu'un roman ou une pièce de théâtre peut l'être; et de trois, ses amateurs sont nombreux, cultivés et n'aiment pas particulièrement se faire passer pour des débiles.
Quand comprendra-t-on que la bande dessinée est un trésor de littérature internationale et qu'il est plus que sain de s'y intéresser? Elle possède ses classiques, ses grands auteurs dont l'oeuvre traverse les âges: pensons à Herriman, à Franquin, à Tezuka, pour ne nommer que trois de ses génies. Elle possède une histoire riche remontant au moins aussi loin qu'au 17e siècle, une théorie bien étoffée, des écrits critiques à profusion.
Plus important encore, la bande dessinée est un art vivant, pratiqué partout dans le monde. Le Festival d'Angoulême s'est récemment imposé comme la référence internationale, équivalent de Cannes sans les paillettes. Une nouvelle garde s'est établie au cours des dix dernières années, révolution comparable à la Nouvelle Vague ou au Nouveau Roman. Cette révolution artistique, dont on voit les fruits autant en France (Sfar, Blain, David B...) qu'aux États-Unis (Clowes, Ware...) ou au Québec (Doucet, Rabagliati...), est systématiquement ignorée par l'essentiel des quotidiens québécois mais, étrangement, pas par Le Monde ni le New York Times qui y consacrent chacun un espace substantiel. Manque de "sérieux" de leur part, sans doute...
La BD québécoise a fleuri au cours de la dernière décennie et produit de plus en plus de livres remarquables. Il est vrai que l'on en parle plus volontiers dans nos journaux, mais rarement et de manière plutôt anecdotique. Qui plus est, on détache cette production du contexte international, essentiel à une bonne compréhension de l'oeuvre. Comment bien saisir tout le rayonnement, toute la subtile originalité de ce que font des auteurs comme Jimmy Beaulieu ou Chester Brown si on ignore ce qui se fait au même moment ailleurs dans le monde? Ce serait aussi absurde que d'analyser Hubert Aquin ou Réjean Ducharme à la seule lumière de la littérature québécoise!
Peut-on imaginer un grand quotidien sans ses critiques de littérature et de cinéma? Alors, à quand une chronique hebdomadaire (voire quotidienne) sur la bande dessinée dans Le Devoir? Les lecteurs s'interrogent...


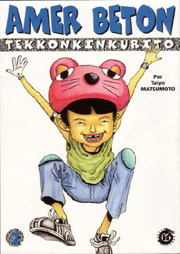 amer béton (de taiyou matsumoto bien sûr) est une lecture bien étrange... évidemment, c'est très bon et très beau: matsumoto maîtrise déjà bien son trait bien qu'il n'est pas encore le virtuose de ping pong. surtout, il sait rendre ses personnages crédibles et c'est un excellent illusionniste: on croit sans peine à toutes ses fantaisies. ses symboles sont gros (le noir et le blanc; les chats, le rat, le serpent; etc.) mais il les détourne de façon assez habile et on reste loin de la psycho de cégep (en fait, en lisant ce genre de livre un peu violent et tapageur, j'ai toujours peur de voir sortir la morale d'idiot, la leçon de vie boboche, le gros pathos braillard qui avaient tant gâché ma (re)lecture du premier cycle de the maxx il y a quelques temps.)
amer béton (de taiyou matsumoto bien sûr) est une lecture bien étrange... évidemment, c'est très bon et très beau: matsumoto maîtrise déjà bien son trait bien qu'il n'est pas encore le virtuose de ping pong. surtout, il sait rendre ses personnages crédibles et c'est un excellent illusionniste: on croit sans peine à toutes ses fantaisies. ses symboles sont gros (le noir et le blanc; les chats, le rat, le serpent; etc.) mais il les détourne de façon assez habile et on reste loin de la psycho de cégep (en fait, en lisant ce genre de livre un peu violent et tapageur, j'ai toujours peur de voir sortir la morale d'idiot, la leçon de vie boboche, le gros pathos braillard qui avaient tant gâché ma (re)lecture du premier cycle de the maxx il y a quelques temps.)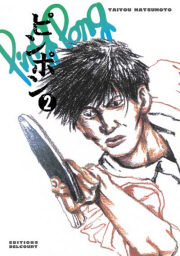 sauf que, sauf que... chez matsumoto, il y a toujours ce sens de l'équilibre à faire ou à briser -- un état d'interdépendance parfait entre deux personnages qui s'effrite, se refait, devient autre chose... l'auteur est allé loin avec ce schéma dans ping pong qui est autrement plus réaliste qu'amer béton. la grande innovation de son oeuvre en cours, l'excellentissime number 5, est finalement qu'elle fait passer cet équilibre binaire à un autre, plus large, qui ressemble davantage à une roue de couleurs représentant les neuf membres de ce que matsumoto appelle l'armée des... rainbows! (bien sûr, il y a aussi un équilibre binaire, beaucoup plus troublant, celui-là entre number 5 et l'étrange matrechka, symbiose aussi grotesque que parfaite.) on imagine l'auteur, penché sur son schéma, établissant des complémentarités parfaites entre ses personnages mais en tournant la roue juste assez pour que les teintes ne soient pas trop pures ni les connections trop évidentes...
sauf que, sauf que... chez matsumoto, il y a toujours ce sens de l'équilibre à faire ou à briser -- un état d'interdépendance parfait entre deux personnages qui s'effrite, se refait, devient autre chose... l'auteur est allé loin avec ce schéma dans ping pong qui est autrement plus réaliste qu'amer béton. la grande innovation de son oeuvre en cours, l'excellentissime number 5, est finalement qu'elle fait passer cet équilibre binaire à un autre, plus large, qui ressemble davantage à une roue de couleurs représentant les neuf membres de ce que matsumoto appelle l'armée des... rainbows! (bien sûr, il y a aussi un équilibre binaire, beaucoup plus troublant, celui-là entre number 5 et l'étrange matrechka, symbiose aussi grotesque que parfaite.) on imagine l'auteur, penché sur son schéma, établissant des complémentarités parfaites entre ses personnages mais en tournant la roue juste assez pour que les teintes ne soient pas trop pures ni les connections trop évidentes...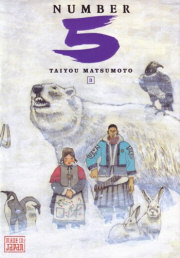 beau trait d'auteur chez matsumoto: il recycle sans cesse ses meilleurs "acteurs". découvrant ses oeuvres dans la chronologie inverse, je suis enchanté de retrouver plus ou moins le personnage du pongiste chinois wenga kon sous les traits du yakuza appelé "le rat" dans amer béton. et on sent évidemment une affection particulière de l'auteur pour son personnage de noiro dans amer béton, qui devient smile, le bon deuxième dans ping pong et (ça ne s'invente pas!) number 2 de l'armée des rainbows dans number 5.
beau trait d'auteur chez matsumoto: il recycle sans cesse ses meilleurs "acteurs". découvrant ses oeuvres dans la chronologie inverse, je suis enchanté de retrouver plus ou moins le personnage du pongiste chinois wenga kon sous les traits du yakuza appelé "le rat" dans amer béton. et on sent évidemment une affection particulière de l'auteur pour son personnage de noiro dans amer béton, qui devient smile, le bon deuxième dans ping pong et (ça ne s'invente pas!) number 2 de l'armée des rainbows dans number 5. un mot (je l'ai promis -- mais à qui? personne le lit ce carnet :) sur le fameux tantrum de jules feiffer, qu'on pourrait traduire par "grosse colère". graphiquement, tantrum ressemble à une collection de dessins de presse mais il ne faut pas s'y tromper: tout cela se suit et forme une "graphic novel" de très bonne facture. sur ce point, on peut pinailler: j'appellerais plutôt cela une "novella" personnellement. m'enfin, c'est un livre qui a son importance historique aux états-unis: on dit de ce livre publié pour la première fois en 1979 qu'il a contribué à inventer la lignée du "graphic novel" dont sont redevables aujourd'hui les spiegelman, ware et compagnie; on pourrait comparer son influence à celle d'ici même de forest et tardi, paru à peu près à la même époque.
un mot (je l'ai promis -- mais à qui? personne le lit ce carnet :) sur le fameux tantrum de jules feiffer, qu'on pourrait traduire par "grosse colère". graphiquement, tantrum ressemble à une collection de dessins de presse mais il ne faut pas s'y tromper: tout cela se suit et forme une "graphic novel" de très bonne facture. sur ce point, on peut pinailler: j'appellerais plutôt cela une "novella" personnellement. m'enfin, c'est un livre qui a son importance historique aux états-unis: on dit de ce livre publié pour la première fois en 1979 qu'il a contribué à inventer la lignée du "graphic novel" dont sont redevables aujourd'hui les spiegelman, ware et compagnie; on pourrait comparer son influence à celle d'ici même de forest et tardi, paru à peu près à la même époque.
0 commentaires:
Publier un commentaire
<< Home